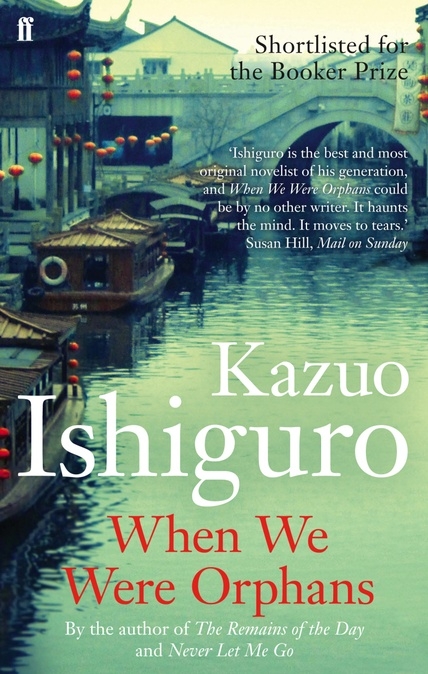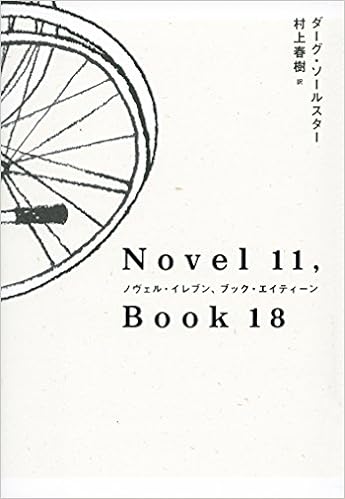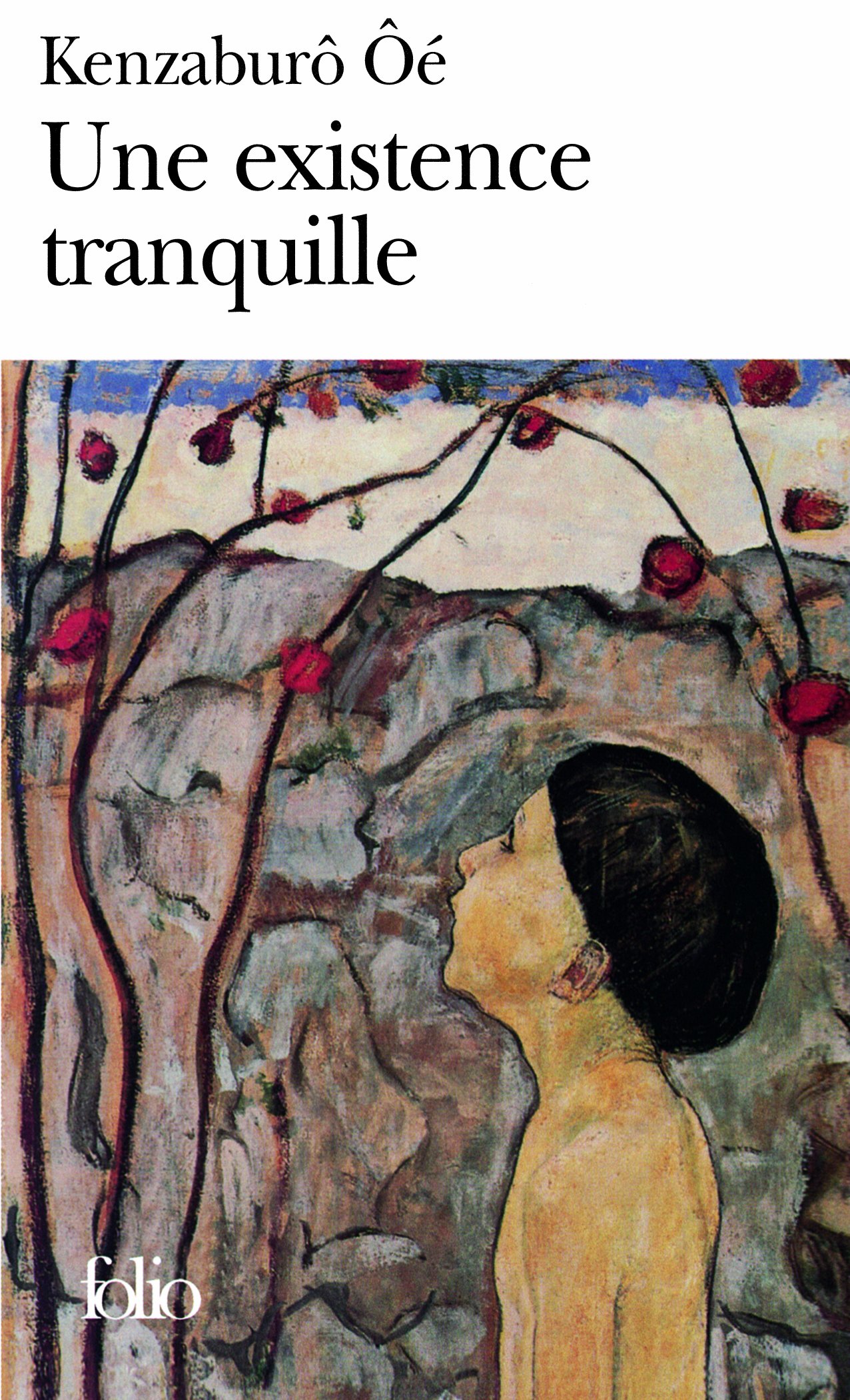J’ai fini aujourd’hui « The Man In
The High Castle » (Le Maître du haut château) de Phillip K Dick. Je pensais à
lire ce livre petit à petit tous les jours avant de dormir, mais je voulais
vraiment connaître la suite, et finalement, je l’ai lu en une semaine.
L’histoire se déroule dans un monde
où les États-Unis sont divisés en deux, d'un côté l’Allemagne nazie et de
l'autre le Japon impérial. Même si ces deux nations se partagent le même
territoire, la technologie de l’Allemagne dépasse largement celle du Japon, et
ce dernier se sent menacé.
Les récits
de plusieurs personnages se déroulent en même temps, de telle sorte qu’il
s’agit plutôt d’un roman polyphonique. L'histoire commence avec la scène où
l’antiquaire Robert Childan se préoccupe du retard d'un objet qu'il a commandé.
S’il n'arrive pas, il doit rendre visite à l’entrepreneur Nobusuke Tagomi pour lui
demander de l’excuser.
Par la suite, ce Nobusuke Tagomi
reçoit la visite d’un homme étrange qui prétend être suédois, Monsieur Baynes.
D'autre part, Frink Frank est un
ouvrier américain viré de son usine. Il vient d’ouvrir une bijouterie avec son
ami Ed. Comme il est juif, il vit en cachant sa véritable identité.
Juliana Frank est l'ex-femme de Frink
qui vit dans les montagnes rocheuses en tant que professeure de judo.
Juliana rencontre un chauffeur de
camion italien qui s’appelle Joe Chinadella. Il lui dit qu’il est un ancien
militaire qui a combattu en Afrique contre les Alliés.
À notre époque, un livre qui parle
d’un monde où l’Allemagne et le Japon ont perdu contre les Alliés est proscrit
par les Nazis. On dit que l'auteur de ce livre intitulé « Le Poids de la sauterelle
» mène une vie solitaire dans un ‘’haut château’’. Joe Chinadella, qui en est
passionné, propose à Juliana d’aller rencontrer cet écrivain, ''le Maître du
haut château''.
Les personnages de ce livre utilisent
souvent une sorte d’oracle chinois quand ils affrontent un problème. Cette
coutume semble répandue dans tous les États-Unis, pas seulement parmi les
Asiatiques.
J’avais regardé aussi la série basée
sur cette œuvre l’année dernière, et c’est l’une des raisons pour laquelle je
voulais essayer le livre. Mais j’ai constaté qu’il y a beaucoup de différences
entre l’œuvre originale et la série. Par exemple, dans le roman les personnages
qui sont très importants dans la série n'apparaissent pas comme le lieutenant
Kido et ‘’ SS Obergruppenführer’’ John Smith. De plus, il n’y a pas de livre
intitulé « Le Poids de la sauterelle », en revanche, il existe des films sur un
monde alternatif où les Alliés sont vainqueurs. Dans le roman Hitler est déjà à
la retraite depuis longtemps et le premier ministre est Martin Bormann. Dans la
série, Hitler est malade, mais toujours au pouvoir.
Les Japonais
qui ont souvent un tempérament violent et cruel dans la série sont décrits plus
positivement dans le roman. Je dirais même qu’ils sont plus ou moins embellis.
En revanche, les Américains sont serviles et moroses. Ce contraste se voit par
exemple dans l’entretien du couple japonais les Kasoura et l’antiquaire
Childan. Tandis que le mari, Paul Kasoura est quelqu’un de sophistiqué, de
cultivé, amateur de jazz de la Nouvelle Orléans, Childan est à la fois complexé
et fier de sa nation. Il se dit dans sa tête qu'il dédaigne ‘’la musique des
nègres’’ et ‘’les jaunes’’.
La véracité est un thème important dans
ce roman. Il y a un passage où le président de l’entreprise où travaillait
Frink, Wyndam Maston explique à une jeune femme, Rita, sur l’authenticité d’un
objet antique.
‘’— Tu ne sens donc pas ? dit-il sur
le ton de la plaisanterie. L’historicité ?
— Qu’est-ce que c’est que ça,
l’historicité ?
— On dit cela d’une chose qui
contient quelque chose appartenant à l’Histoire. Écoute. L’un de ces briquets
Zippo se trouvait dans la poche de Franklin D. Roosevelt quand il a été
assassiné. Et l’autre n’y était pas. L’un a de l’historicité à un point
terrible ! Autant qu’un objet a pu jamais en contenir. Et l’autre n’a rien. Tu
le sens ? (Il lui donna un coup de coude.) Non ? Tu ne vois aucune différence.
Il n’y a pas de « présence plasmique mystique » ni d’« aura » autour de cet
objet ?’’
Cette question sur les briquets
s’applique aussi aux deux mondes, l’un où les États-Unis sont gagnants, l’autre
où ils sont perdants.
De plus, certains personnages ont
aussi une fausse identité. Frink a changé son nom pour cacher son origine juive. Monsieur Bayens que Monsieur Tagomi reçoit n’est en réalité pas un entrepreneur suédois, mais un officier nazi qui lui rend visite en secret pour lui donner une
information confidentielle. Et Joe Chinadella, un homme avec des traits
méditerranéens n’est évidemment pas un simple chauffeur de camion.
À la fin de
l’histoire, l’auteur de « Le Poids de la sauterelle », Abendsen dit à Juliana
que c’est l’oracle qui a écrit ce livre pour faire surgir la vérité intérieure.
Juliane se demande si lequel est vrai, le monde auquel elle appartient ou le
monde qu'a écrit Abendsen dans son ouvrage.
Une petite parenthèse sans importance : J’imagine que Phillip K Dick n’avait pas d’amis
japonais, et en 1962, lorsque ce roman a paru, il n'y avait pas encore Google.
Je le dis car les noms des personnages japonais sont tous un peu étranges. «
Tagami » existe comme nom de famille, mais pas « Tagomi ». De la même manière,
« Kajiura » existe, mais pas « Kasoura ». Dans la série, ça se voit qu’ils ont
recruté des acteurs d’origine japonaise, mais leur langue n’est pas très
naturelle, sauf celle de Betty Kasoura dont l'actrice est probablement native.